
La visite médicale est lorsque le médecin ou infirmière de santé au travail (qui forment le Service de Santé et Prévention au Travail), vérifient que votre poste de travail est adapté à votre état de santé.
Le médecin du travail vous informe alors des risques d’exposition à votre poste et vous indique les moyens de prévention et de surveillance à mettre en place pour préserver votre santé.
L’absence de visite médicale n’est pas sans risque pour l’employeur. Le non-respect de ses obligations est passible de sanctions pénales prenant la forme d’une amende (article R. 4745-1 du Code du travail) voire même d’une peine de prison en cas de récidive (article L. 4745-1 du même code).
La visite médicale a lieu soit dans le service inter-entreprises dont l’employeur est adhérent, soit dans le service de santé au travail de l’entreprise. S’il s’agit d’une entreprise de plus de 500 salariés, l’examen médical se fait obligatoirement dans l’établissement. Depuis le 31 mars 2022, il est également possible de passer une visite médicale à distance. Cette possibilité nécessite l’accord du salarié. Le dispositif utilisé doit en outre respecter la confidentialité des échanges.
Le temps passé au cours de la visite médicale ne doit pas conduire à une baisse de la rémunération du salarié. Le Code du travail prévoit ainsi que cette période doit être prise soit :
- sur les heures de travail, et dans ce cas elle ne peut donner lieu à aucune retenue de salaire ;
- en dehors des heures de travail, et dans ce cas elle doit être rémunérée comme du temps de travail effectif.
Aussi, les frais de transports sont pris en charge par l’employeur.
 Il existe plusieurs types de visites médicales :
Il existe plusieurs types de visites médicales :
Par qui ?
La VIP est la première visite médicale effectuée par le salarié lors de son embauche. Le travailleur est évalué par :
- un professionnel de santé au travail (collaborateur médecin, interne en médecine du travail…) si le salarié ne présente aucun risque ; puis un médecin si cela est nécessaire
- un médecin du travail si le salarié est travailleur handicapé, bénéficiant d’une pension d’invalidité ou travailleur de nuit.
>> La visite médicale a pour but de contrôler la santé du salarié et de le sensibiliser aux dangers de son travail.
Après la visite médicale de recrutement, chaque employé dispose d’un dossier médical concernant sa santé au travail.
Après cette visite médicale d’embauche, le médecin remet au salarié et à l’employeur une attestation de suivi professionnel.
Pour qui ?
Tous les salariés sont concernés CDD, CDI, Apprenti, intérim.
Quand ?
La visite médicale doit être effectuée dans un délai de 3 mois suite à la prise du poste du salarié, ou 2 mois lorsqu’il s’agit d’un apprenti.
A savoir que les travailleurs de nuit ou les employés de moins de 18 ans doivent obligatoirement effectuer une visite médicale avant le début du contrat de travail.
Cette visite médicale devra être renouvelée tous les 5 ans à partir de la date de la première.
A noter pour les salariés en situation de handicap et les travailleurs de nuit ; la VIP doit être renouvelée tous les 3 ans.
En application de l’article R. 4624-22 du Code du travail, certains salariés bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, appelée « suivi individuel renforcé ».
Pour qui ?
Pour les salariés exposés à certains risques tels que le plomb ou l’amiante, les agents cancérigènes, la chute de hauteur suite à des opérations de montage ou de démontage d’échafaudages, etc.
De quoi s’agit-il ?
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d’aptitude effectué par le médecin du travail avant l’affectation du poste pour permettre :
- de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, notamment en vérifiant la compatibilité de ce poste avec son état de santé, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues,
- de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres travailleurs,
- de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes,
- d’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire,
- de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
A la fin de l’examen, il remet un avis d’aptitude ou d’inaptitude qui est alors remis au salarié et à son employeur.
Quand ?
Le suivi médical renforcé se fait avant l’embauche du salarié.
A l’issue de l’examen médical d’embauche, le salarié bénéficiera d’un renouvellement de cet examen, effectué par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut pas être supérieure à 4 ans.
Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard deux ans après l’examen médical d’aptitude d’embauche réalisé par le médecin du travail.
Elle a pour objet d’accompagner le salarié dans sa reprise de travail après un arrêt de travail d’une certaine durée ou d’un congé maternité
Pour qui ?
L’employeur a l’obligation de passer une visite médicale de reprise :
- après un congé de maternité,
- après une absence pour cause de maladie professionnelle,
- après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail,
- après une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.
L’intérêt est de vérifier si le poste de travail est compatible avec l’état de santé du salarié, d’examiner les éventuelles propositions d’aménagement de poste, d’adaptation de poste, d’émettre un avis d’inaptitude.
S’agissant de la visite de pré-reprise, celle-ci a lieu à la demande du salarié, de son médecin traitant ou du médecin conseil de la Sécurité sociale.
Cette visite de pré-reprise est mise en place en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés concernés.
Quand ?
Pour la visite de reprise, l’examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours.



 Il existe plusieurs types de visites médicales :
Il existe plusieurs types de visites médicales :


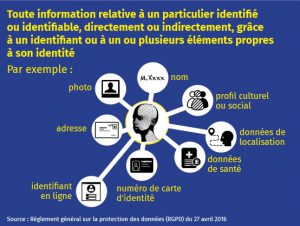





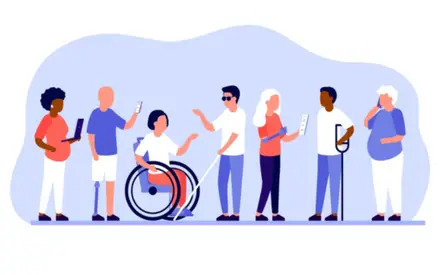 Quand doit-être transmise la DOETH ?
Quand doit-être transmise la DOETH ?
